L’Exposition d’œuvres d’art mutilées (1916-1917)
Le 24 novembre 1916 est inaugurée à Paris une Exposition d’œuvres d’art mutilées ou provenant des régions dévastées par l’ennemi, en présence du président de la République. Durant un an, près de 300 pièces provenant de diverses zones du front sont exposées au Petit Palais. Cette manifestation illustre l’instrumentalisation du patrimoine culturel, mobilisé comme incarnation de la nation blessée pour fédérer les Français et dénoncer l’ennemi.
« Le musée des atrocités allemandes »
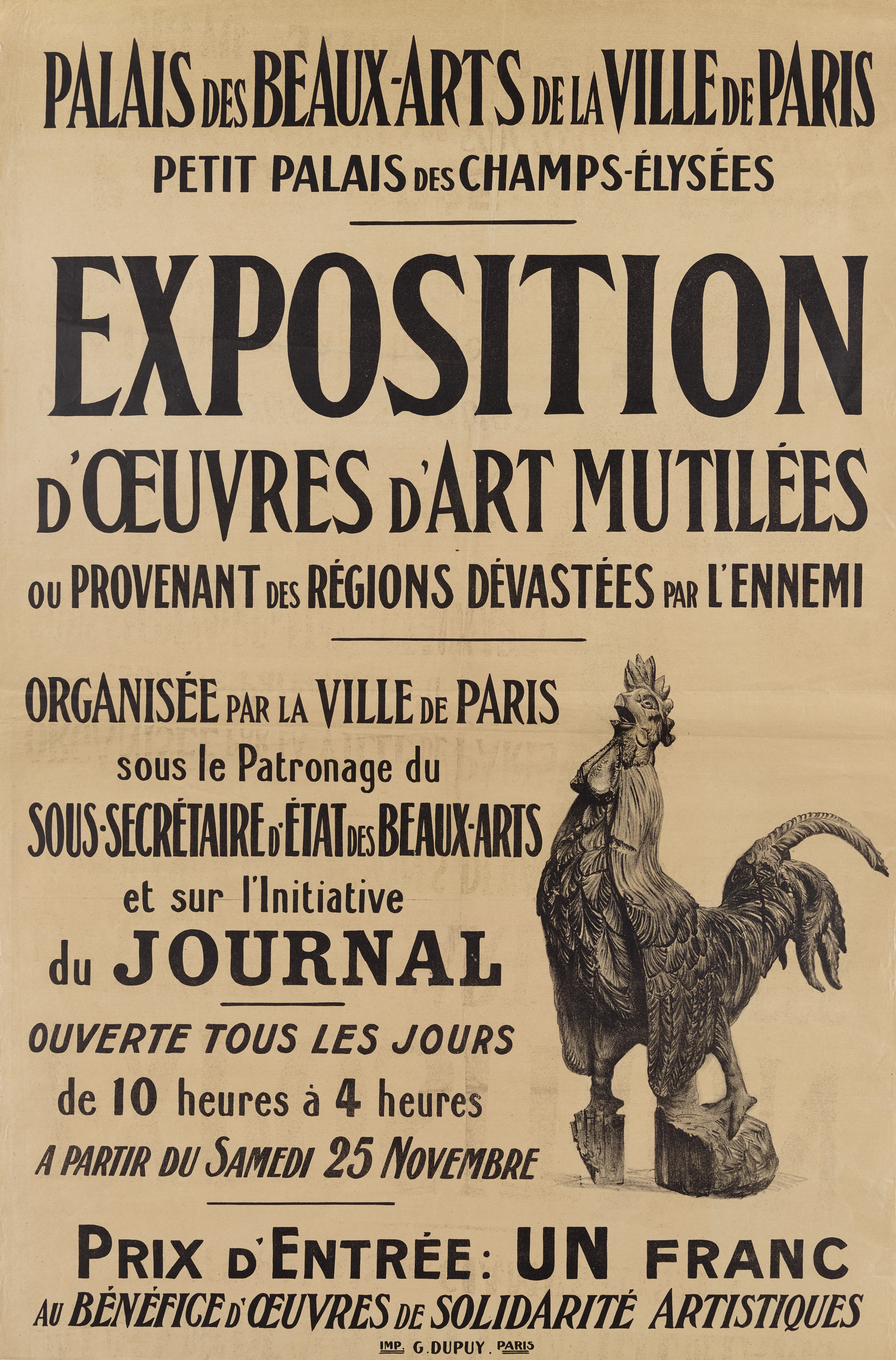
ou provenant des régions dévastées par l’ennemi.
25 nov 1916 – 4 déc 1917.
Surnommée dans la presse « exposition du vandalisme allemand » ou encore « musée des atrocités allemandes », l’exposition a pour objectif explicite de dénoncer la barbarie allemande, comme l’exprime l’avant-propos du catalogue : « La vision de ces grandes misères des contrées où a passé l’ennemi entretiendra-t-elle contre lui l’implacable haine nécessaire. » Les œuvres présentées apparaissent comme des preuves tangibles de la volonté ennemie de détruire l’âme de la culture française, mais aussi comme des pièces à conviction pour de futurs procès. Le discours se déploie sur deux registres : d’un côté, la France martyrisée par la guerre, incarnée par son patrimoine ; de l’autre, la France héroïque qui reconquiert, défend et sauve ce patrimoine, comme en témoigne l’exposition. L’exposition a également pour vocation de convaincre les pays neutres de la légitimité de la France à se défendre contre la barbarie allemande, dont les effets sont soigneusement scénographiés.
Un parcours symbolique le long de la ligne de front
Les œuvres et objets sont présentés selon un parcours méthodiquement tracé. Le visiteur suit symboliquement la ligne de front, de Dunkerque dans le Nord jusqu’à Thann en Alsace, pour terminer dans une salle à la mise en scène dramatique consacrée à Verdun, dont la bataille se poursuit depuis près d’un an. Les sites emblématiques comme Reims, Arras ou Verdun occupent une place centrale dans le plan de l’exposition. Certains objets, tels que le lion du beffroi d’Arras, la Pietà de l’église de Souain, les tapisseries de Reims ou les boiseries de Verdun, forment les « clous » de l’exposition, présentés comme autant de preuves matérielles de l’infamie allemande. L’avant-propos du catalogue de l’exposition précise : « Si tous les monuments, tous les chefs d’œuvre d’architecture allaient au diable, a dit le général Von Disfurth, cela nous serait parfaitement égal… On nous traite de barbares ? Qu’importe ? Nous en rions. »

Novembre 1916, Petit Palais (Paris).
© Albert Moreau/SPA/ECPAD/SPA 144 M 2937
Corps fragmentés et humanisés

Novembre 1916, Paris.
© Albert Moreau/SPA/ECPAD/Défense/SPA 144 M 2940
L’exposition confère aux objets un statut de victimes : sculptures et fragments architecturaux sont assimilés à des êtres humains blessés. Cette personnification vise à susciter l’empathie et l’indignation des visiteurs. La mise en scène des fragments corporels est particulièrement soignée. Ici la tête de saint Tarcisius, réalisée par Alexandre Falguière, est isolée dans une vitrine, sur un socle couvert de velours, au pied duquel sont posés d’autres fragments évoquant des restes humains déchiquetés. L’usage de la photographie apposée sur le socle vient renforcer cette mise en scène en montrant des clichés des sculptures « avant » et « après » détérioration. Ce procédé confère aux œuvres exposées la capacité d’exprimer ce qu’elles ne montrent pas directement : la violence et l’horreur de la guerre.
Des œuvres manipulées
Cette manifestation n’est ni un salon des armées, ni une exposition de Beaux-Arts, mais plutôt une hybridation entre des catégories d’artefacts de différente nature, dont la combinaison est susceptible de susciter une « émotion patrimoniale » :
- des pièces sans valeur artistique mais à forte charge symbolique (par exemple, une caisse d’éclats d’obus de Verdun, ou une « larme » de plomb provenant de l’incendie de la cathédrale de Reims) ;
- des fragments d’art et d’artisanat (statues abîmées, éléments d’architecture, objets liturgiques endommagés), choisis pour leur provenance d’un site emblématique comme Reims ou Soissons ;
- des chefs-d’œuvre civils ou religieux, parfois intacts mais dont l’exposition renforce l’effet dramatique. Certains sont classés monuments historiques, comme la Pietà de Souain (Marne).
Cette sculpture champenoise du XVIᵉ siècle y apparait très abimée. Le Christ a perdu son bras droit, emporté par un éclat d’obus, et la vierge apparait décapitée. En réalité, elle a perdu sa tête bien avant la guerre. Celle-ci se trouvait dans l’église lors du bombardement, mais cette information est passée sous silence dans le catalogue (une brochure qui sert de guide aux visiteurs), permettant à la presse d’exploiter cette image comme une preuve extrême de la barbarie allemande.

Novembre 1916, Petit Palais (Paris).
© Albert Moreau/SPA/ECPAD/SPA 144 M 2941
Recherche sur le site ImagesDéfense
| MOTS-CLÉS | Exposition, art, mutilé | 5 résultats |
| FILTRES | Type : reportage Période : Première Guerre mondiale |
Pistes pédagogiques
- Dans la peau … d’un visiteur de l’exposition
- Si les statues pouvaient s’exprimer…