Mobilisation de l’arrière – Une menace pour toute la société
Dossier pédagogique de l’exposition Derrière les masques. Photographies des deux guerres
Revenir sur la page page principale du dossier
Une peur généralisée
À partir du printemps 1915, l’utilisation des gaz toxiques constitue un choc pour les populations. La nature nouvelle et invisible de cette menace — un gaz inodore ou difficile à détecter — engendre une peur diffuse, renforcée par les rumeurs, l’angoisse face à la souffrance des victimes et le sentiment d’impuissance. La presse relaie les premières publicités pour les masques qui vantent leurs qualités, sans se référer à un modèle officiel, puisqu’il n’en existe pas. Ce contexte anxiogène est favorable aux escroqueries : dès l’été 1915, le quotidien Le Matin alerte sur les fraudes de fabricants de masques (ce qui n’empêche pas les publicités de continuer à alimenter les pages des journaux comme en témoigne celle figurant sur la même page du Matin).
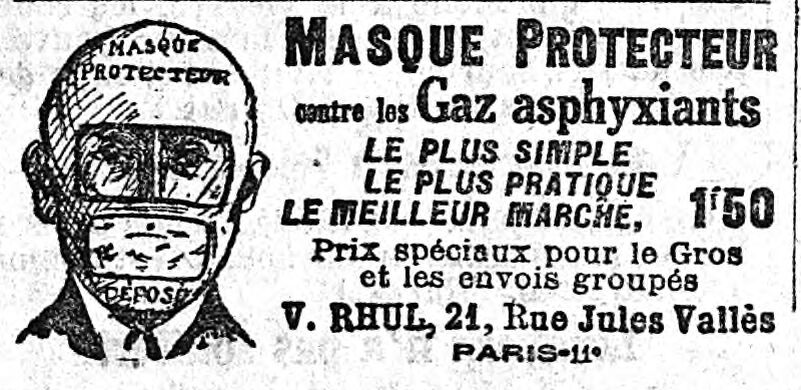
Équiper et rassurer
Dans les villes exposées aux bombardements chimiques, des masques sont distribués aux civils et des avis officiels sont placardés. Les clichés d’infirmières (photographie n°6), d’enfants (photographie n°9) et même de chiens (photographie n°7) équipés de masques s’inscrivent dans une stratégie visant à rassurer quant à la capacité des autorités à protéger toute la population. Il en va probablement de même pour la mise en scène photographique montrant les employés de la mairie de Reims « avant/après » la mise en place du masque (photographie n°8). On y perçoit toutefois les limites d’une telle communication : les masques semblent hétérogènes, ce qui traduit la difficulté des autorités à pérenniser l’usage d’un modèle de masque unique et efficace ; et ils semblent complexes à enfiler, alors même que les conditions sont très éloignées de celles d’une attaque réelle.
FOCUS IMAGE – Groupe d’enfants munis de masques contre les gaz asphyxiants
En février 1916, le photographe Jacques Agié se rend pour le compte de la Section photographique de l’armée (SPA) en Meurthe-et-Moselle, non loin de la ligne de front. Les 57 photographies de son reportage documentent principalement la vie et les installations militaires. Cette photographie d’un groupe d’enfants portant des masques à gaz fait quasi figure d’exception dans ce reportage. Un film conservé nous restitue le contexte de l’image : « La lutte contre les gaz asphyxiants » réalisé par la Section cinématographique de l’armée (SCA) en 1916 s’achève par une séquence tournée quelques instants avant cette photographie. On y voit des femmes (religieuses) en train de mettre les masques aux enfants, et l’on perçoit que la tâche n’est pas aisée.

Groupe d’enfants munis de masques contre les gaz asphyxiants.
Lorraine – Meurthe-et-Moselle – Pont-à-Mousson, 1er – 28 février 1916, Jacques Gabriel François Agié. SPA/SPCA/ECPAD/SPA 12 X 420.
Le premier plan de l’image est occupé par une large portion de sol, conséquence de la probable indication du photographe qui souhaite avoir une vue d’ensemble du groupe dans un espace contraint et couvert, qui confine à l’enfermement. L’effet produit est celui de la « matérialisation » du gaz, l’ennemi invisible qui semble repousser les enfants au 2e plan.
Les blouses et sacoches d’écoliers — qui sont en réalité des étuis de transport pour les masques — suggère un contexte scolaire qui devrait être rassurant par sa « normalité » dans un contexte de guerre (perceptible par les sacs de sable derrière eux). Avec leurs visages couverts de bandages, encadrés par des infirmières (reconnaissables à leur blouse et leur calot brodé d’une croix), il évoquent toutefois davantage des rescapés d’incendie, des grands brûlés… L’absence de regard caché derrière les lunettes de protection accentue la déshumanisation. La dureté de l’image est renforcée par la fermeture des visages des quelques adultes non masqués. Tous ces aspects contribuent à expliquer l’atmosphère glaçante qui se dégage de ce cliché à double tranchant : à la fois rassurant sur la prise en charge de la protection des enfants, mais aussi dénonciateur : ils sont montrés comme les victimes innocentes de l’arme chimique, fruit de la perfidie allemande.
Piste pédagogique – Enquête autour d’une affiche de consignes officielles
Dans les villes exposées aux bombardements chimiques, les autorités communiquent notamment par voie d’affichage dans l’espace public.
Le document Notice pour la population civile concernant les gaz asphyxiants, conservé à l’ECPAD, en est un exemple. Daté du 15 janvier 1916 et destiné à la ville de Pont-à-Mousson, il endosse une double dimension pédagogique : expliquer le fonctionnement des attaques aux gaz, et comment s’en protéger.
Identifier le document
Ce document peut être communiqué « brut » aux élèves, en effaçant préalablement la date. On peut proposer aux élèves une enquête pour en identifier la nature, la fonction et la date. Des documents complémentaires sont mis à leur disposition :
- une photographie de l’affiche en contexte urbain
(lien vers l’image) ; - une chronologie relative à la « guerre des gaz » en France durant la Première Guerre mondiale (télécharger au format PDF).
Nature
Relever les éléments qui permettent de l’identifier comme un document officiel destiné à être affiché dans l’espace public.
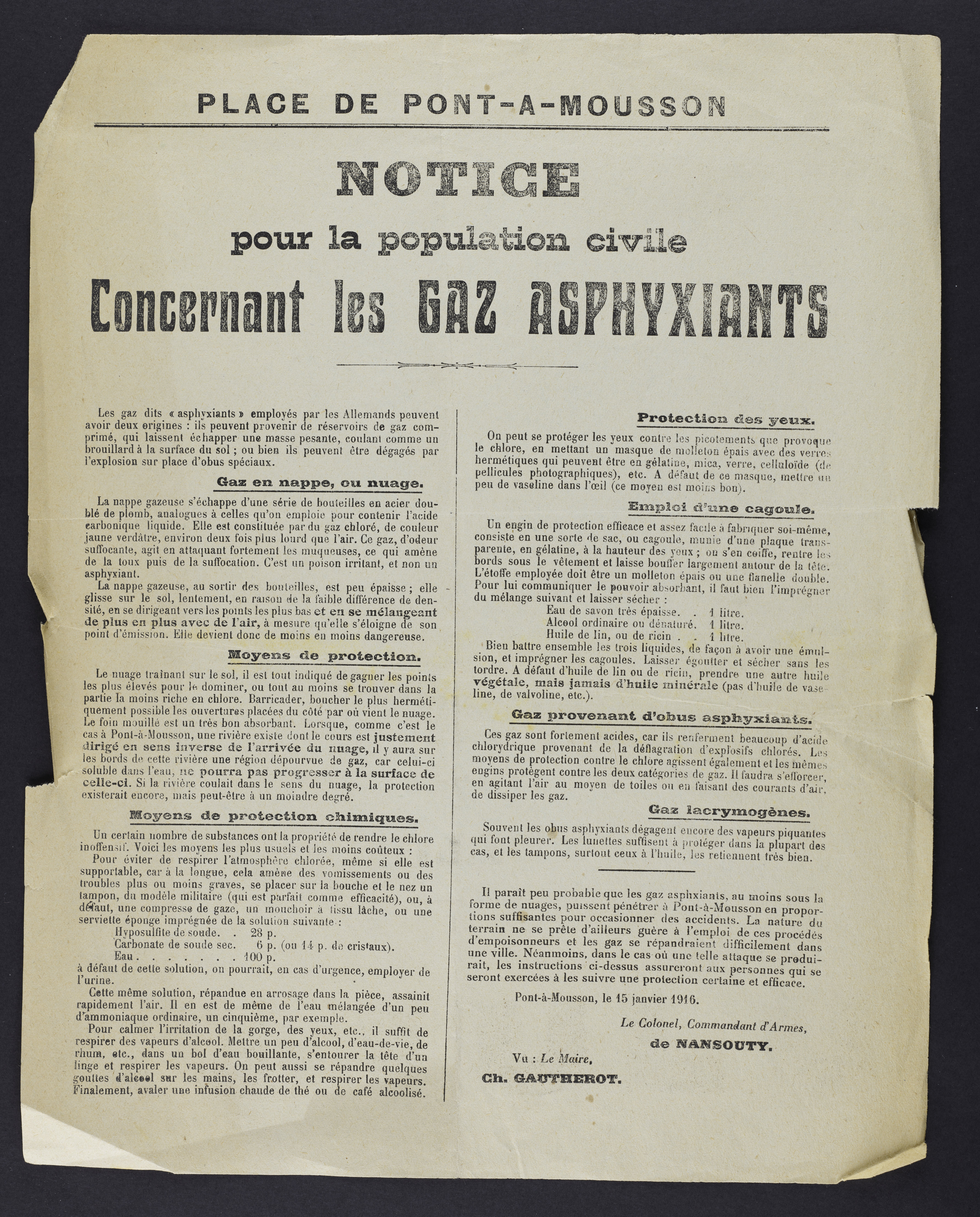
Date
La première attaque date d’avril 1915.
La chronologie indique que le masque M2 couvrant le visage, qui sera fabriqué à 29 millions d’exemplaires, est mis au point en février 1916. Il n’est manifestement pas encore distribué à l’époque de rédaction du document, qui se situe avant la généralisation et la distribution des masques. Les conseils donnés sont très pragmatiques et rudimentaires, à portée de tous dans l’urgence après les premières utilisations de gaz :
La nature des gaz :
Pour aller plus loin
Sur le site de la ville de Reims, un exemple développé de gestion de la menace du gaz sur la population civile dans une ville, avec des documents variés.

